Par Pierre Bailly, Maître de conférences honoraire, Université Grenoble-Alpes
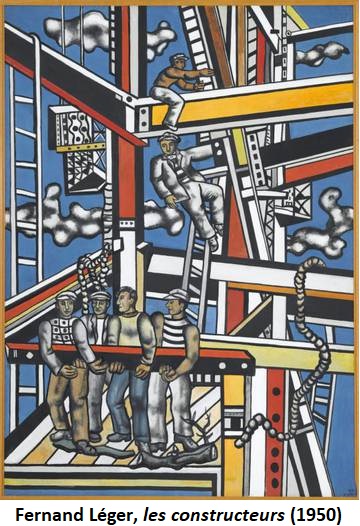 Les évolutions, en cours, des emplois et du travail perpétuent cette propension inhérente au capitalisme à bouleverser en permanence les conditions de production et de travail pour assurer sa perpétuation et son expansion. Après des siècles de transformations technologiques indéniables des sociétés paysannes, la structuration des capitalismes dans quelques pays de l’Europe occidentale des villes italiennes et flamandes à la France et la Grande-Bretagne (Pomeranz, 2010) accélère le rythme des changements des activités productives et corrélativement les organisations sociales. Les sociétés paysannes se transforment graduellement en sociétés salariales, le travail salarié devient la norme de l’activité. Pour n’en rester qu’aux mutations depuis la Révolution française, la transformation des structures des activités en France se traduit par une régression des actifs ruraux principalement dans l’agriculture auxquels se substituent tout d’abord les actifs urbains de l’industrie des villes moyennes, eux-mêmes remplacés par les actifs métropolitains des services (Institut national de la statistique et des études économiques, 1991).
Les évolutions, en cours, des emplois et du travail perpétuent cette propension inhérente au capitalisme à bouleverser en permanence les conditions de production et de travail pour assurer sa perpétuation et son expansion. Après des siècles de transformations technologiques indéniables des sociétés paysannes, la structuration des capitalismes dans quelques pays de l’Europe occidentale des villes italiennes et flamandes à la France et la Grande-Bretagne (Pomeranz, 2010) accélère le rythme des changements des activités productives et corrélativement les organisations sociales. Les sociétés paysannes se transforment graduellement en sociétés salariales, le travail salarié devient la norme de l’activité. Pour n’en rester qu’aux mutations depuis la Révolution française, la transformation des structures des activités en France se traduit par une régression des actifs ruraux principalement dans l’agriculture auxquels se substituent tout d’abord les actifs urbains de l’industrie des villes moyennes, eux-mêmes remplacés par les actifs métropolitains des services (Institut national de la statistique et des études économiques, 1991).
La croissance du salariat et de la population active déforme la structure des emplois. L’importance des catégories d’emploi des classes moyennes s’accroit au détriment des catégories populaires et des indépendants. Entre 2006 et 2021, la part des «cadres supérieurs » passe de 15,7 à 21,6 % des emplois, celle des « professions intermédiaires », augmente de 23,1 à 24,7 %[1], soit environ 46 % des emplois, soit une part analogue à celles « des personnels d’exécution » (ouvriers, employés) ou 45,3 % (dont 61 % sont qualifiés). L’importance des indépendants se stabilise autour de 6 % (en partie avec l’expansion des autoentrepreneurs), la régression des agriculteurs exploitants se confirme.
Structure des catégories socioprofessionnelles en %
|
2006 |
2016 |
2021 |
|
|
Agriculteurs exploitants |
2,5 |
1,8 |
1,5 |
|
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise |
6,3 |
6,6 |
6,5 |
|
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
15,7 |
17,8 |
21,6 |
|
Professions intermédiaires |
23,1 |
25,8 |
24,7 |
|
Personnels d’exécution (ouvriers, employés) |
52,2 |
47,7 |
45,3 |
|
Ouvriers |
23,2 |
20,3 |
19,1 |
|
Employés |
29,0 |
27,4 |
26,2 |
Source : Insee
La modification des emplois s’accompagne de la part grandissante des activités de services, un phénomène général comme l’indiquent les données européennes.
Évolution de la structure sectorielle de l’emploi dans l’UE (en %)
|
Agriculture |
Industrie |
Construction |
Tertiaire |
|
|
2000 |
8,6 |
19,9 |
6,9 |
64,6 |
|
2021 |
4,4 |
15,7 |
6,7 |
73,2 |
|
France 2021 |
2,0 |
11,4 |
6,7 |
79,9 |
Source : Eurostat.
La réduction des activités agricoles et industrielles, l’importance des emplois de type « classes moyennes » entraîne une plus grande abstraction des tâches. Cette évolution témoigne d’une progression de l’usage des dispositifs numériques associée à une croissante demande de formation, de qualification et de compétence. La rapidité des transformations explique, pour partie, les difficultés d’employabilité d’une partie de la population en âge de travailler. Les transformations actuelles du capitalisme, de la géoéconomie mondiale, du travail et de son organisation ne constituent qu’un nouvel avatar des bouleversements productifs rapides, au plan historique, depuis son apparition au XVIIe siècle.
L’analyse proposée ici situe les mutations du travail dans l’épuisement du modèle fondé sur le compromis social-démocrate de recomposition du capitalisme après l’effondrement du système colonialiste européen (la première mondialisation) au cours des années 1914-1920. Les hypothèses et les réflexions sur les mutations du travail s’appuient sur une compréhension de la généralisation du travail salarié comme producteur de richesse et la succession de périodes longues de stabilité entrecoupée de périodes de bifurcation (première partie) et sur l’analyse de l’épuisement du modèle antérieur d’organisation du travail (l’OST : organisation scientifique du travail ou taylorisme) (deuxième partie) et de l’apparition progressive de nouvelles formes de travail et d’emplois (troisième partie) contribuant à l’invention d’un nouveau modèle socio-économique (Conclusion).
I. Le travail au cœur de la dynamique du capitalisme
Les mutations du travail et de son organisation scandent les phases du capitalisme dans une succession de paradigmes socio-technico-économique. La compréhension des mutations du travail et son avenir nécessitent de préciser la notion de travail à un moment où l’équivalence proclamée entre toutes les activités humaines entraîne un risque d’effacement de la spécificité conceptuelle et concrète du travail. Elle ne facilite pas non plus l’analyse de l’utilité économique et sociale de ces activités (Méda, 2005).
A. Le travail salarié inhérent au capitalisme et à la modernité
Avec l’avènement du capitalisme industriel au XVIIe siècle, la transformation des sociétés paysannes en société industrielle se réalise de façon progressive en Europe occidentale avec une salarisation croissante du travail (Méda, 2005). Elle résulte de mutations économiques des formes de production de richesses soutenues par les États. Pour d’autres zones, l’expansion rapide et autoritaire du travail salarié résulte de choix politiques assumés comme pour le Japon de l’ère Meiji (1868-1912), l’industrialisation soviétique, les dragons asiatiques, les pays émergents et actuellement en Afrique (Éthiopie, Ghana).
Avant l’émergence du capitalisme et du travail libre (non contraint par le servage ou les normes des corporations ou religieuses), les activités de transformations de la matière pour la production en vue de l’échange et le commerce étaient méprisées, au profit des activités libres (activité politique, religieuse). Le XVIIIe siècle et les Lumières inventent la catégorie de travail et célèbrent sa valeur, sans nier le caractère déshumanisant de la division du travail. Pour Adam Smith (Smith, 1776), et les économistes classiques, le travail produit la richesse et fournit l’unité de mesure abstraite de la production des marchandises.
L’évaluation de la production par les quantités de travail appartient au domaine de la spéculation théorique, comme d’ailleurs celle de la mesure par l’utilité défendue par les économistes, marginalistes ou néoclassiques de la fin du XIXe siècle, qui renouent avec une représentation négative du travail comme désutilité, comme l’a montré A. Orléan (Orléan, 2013).
Le travail représente également une libération en vue d’obtenir un revenu (monétaire) grâce à une activité personnelle. L’Encyclopédie, contre la vulgate religieuse qui associe le travail au mal, défend une approche humaniste du travail : une contrainte (pour satisfaire des besoins) ainsi que des possibilités de réalisation de soi (Diderot, D’Alembert & Jaucourt, 2019). La traduction politique de cette vision du travail conduit la Constitution de 1793 à inclure le travail parmi les droits de l’Homme, alors qu’il était absent de la déclaration de 1789 (Conseil constitutionnel, 2019) ; position confirmée par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ONU, 2015). À cette vision optimiste, les penseurs socialistes révolutionnaires, dont K. Marx, opposent, au cours du XIXe siècle, une approche critique et négative du travail salarié. Il devient le symbole de la misère, de la sujétion et de la contrainte, sa suppression devient un objectif majeur. Les auteurs néoclassiques réduisent, comme les socialistes, le travail à une désutilité en opposition à l’utilité du loisir. Pour la pensée sociale-démocrate, qui domine le XXe et le début du XXIe siècle, l’abolition du salariat comme de l’État appartient à des utopies dangereuses pour les libertés. Au contraire, le travail salarié devient le moyen d’accéder aux richesses et peut constituer une forme d’épanouissement humain individuel et collectif dans la démarche des Lumières ou de Marx pour subvertir l’ordre social existant. L’État doit assurer le plein emploi et redistribuer équitablement les richesses produites.
La réduction du travail à une souffrance, illustrée par des images du film de C. Chaplin « Les temps modernes » (utilisées pour annoncer un débat sur le travail sur France Culture le 27 mars 2019), perdure et en occulte la diversité, la complexité et la réalité. Le concept de travail contemporain combine quatre dimensions hétérogènes : un facteur de production, une essence de l’homme, une source de revenus et de droits, un support à l’intégration sociale. Le travail regroupe l’ensemble des activités humaines socialement organisées (au sein d’une unité de production) rémunérées en vue de la production pour des tiers (sauf la production pour compte propre) de biens et des services marchands ou non marchands en vue d’obtenir un revenu soit comme travailleur indépendant soit comme travailleur salarié pour le compte et sous la direction d’un employeur. La distinction juridique entre ces deux situations repose sur l’existence d’un contrat de travail pour le salarié et de la vente du ou des produits pour le travailleur indépendant. Une même personne peut passer dans la même journée du statut de salarié, voire de retraité, à celui de travailleur indépendant. Ce qui ne réduit pas l’incertitude du travail concret.
L’organisation du travail comme son contenu évoluent en permanence au sein d’un mode de régulation d’ensemble du capitalisme (Destanne de Bernis, 1977), cette accumulation itérative de modifications conduit à une rupture du mode dominant d’organisation du travail ouvrant la voie à une période d’incertitude dont émerge une nouvelle configuration.
II. La succession des paradigmes socio-technico-économiques
L’histoire du capitalisme est structurée par de longues périodes de stabilité coupée de périodes plus courtes de transition ou plutôt de bifurcations au cours desquelles s’impose un nouveau paradigme technico-économique. La bifurcation actuelle signe le passage vers des technologies de l’information et la communication avec de nouvelles formes d’automatisation en continuité avec des technologies antérieures. Le travail est fortement touché par ces bouleversements avec le passage de la transformation de la matière vers le traitement de l’information. Le vocable de troisième révolution industrielle, utilisé, pour caractériser cette mutation, se réduit à la banalisation et à l’usage massif des outils et techniques numériques dans la production sur la base des évolutions de techniques existantes inventées dans le contexte de l’ancien paradigme, souvent à des fins militaires, comme les ordinateurs (l’ENIAC), ou Internet, un sous-produit de la Guerre froide, en réaction à IBM comme les microordinateurs ou pour des besoins scientifiques comme le Web. L’enjeu tient à la maîtrise des technologies en cohérence avec une organisation du travail compatible avec les compétences demandées aux salariés, dans le cadre d’un modèle social et politique renouvelé.
Les « révolutions industrielles » se traduisent par une mutation radicale de l’organisation du travail. La première marque le passage de la manufacture à la fabrique avec l’organisation de la division du travail autour de la machine à vapeur, souvent produite par des artisans, le charbon devenant la source d’énergie dominante (XIXe siècle), la seconde révolution mobilise les ressources de la science pour améliorer la division du travail avec l’OST avec la production industrielle des machines alimentées par l’électricité ou le pétrole (XXe siècle). Enfin, ladite troisième révolution industrielle se caractérise par le recours massif aux techniques du traitement de l’information, désormais sous un format numérique et l’éloignement du travailleur de la transformation de la matière (XXIe siècle). Ces périodes peuvent être analysées plus comme des bifurcations (le plus souvent associées à des conflits majeurs) dans la dynamique du capitalisme que de « simples crises » systémiques du capitalisme.
Dans le champ de la théorie économique, Nicolaï Kondratiev (1892-1938) (Kondratiev, 1992) introduit l’idée de cycle long et note une coïncidence entre les « révolutions industrielles » et les périodes de transformations profondes du capitalisme. Lesdites « révolutions industrielles » se déroulent sur le temps long au cours duquel de multiples innovations en rupture avec le modèle ancien apparaissent, disparaissent puis se stabilisent pour constituer le nouveau paradigme.
Ces périodes de bifurcation ou de transition d’un paradigme à l’autre entraînent une modification des conditions de production, des moyens de production, de l’organisation du travail, du marché de l’emploi, des formes de distribution, des styles de vie (Valenduc, 2018). En ce sens, le terme de révolution industrielle, parfois galvaudé, traduit bien ce sentiment de refondation de l’organisation productive et du travail. Le nouveau paradigme se propage dans l’ensemble de l’économie, en fonction des choix politiques, des rapports sociaux, des conflits sociaux, des stratégies des acteurs pour finalement se traduire par des compromis sociopolitiques (explicites et implicites) (Thévenot, 1985).
Après chaque bifurcation, les mutations profondes du capitalisme correspondent à une nouvelle forme de travail et de son organisation et de la condition des salariés. Durant les périodes de stabilité, une forme d’organisation de travail domine les autres. Autour de 1750, la fabrique et la division du travail (structuration des salariés) se substituent à la manufacture (regroupement de salariés sans coordination des travaux) et retirent aux salariés la régulation de la production (Smith, 1776). Ensuite, dès la fin du XIXe, l’OST (associée au nom de F. Taylor et H. Fayol) rationalise la séparation de la conception et de l’exécution des tâches, cette folie rationnelle (Doray & Godelier, 1981) et domine les normes de l’organisation du travail. Ces nouvelles formes n’apparaissent pas spontanément, elles généralisent et développent des innovations antérieures apparues pour répondre aux difficultés du modèle pour des raisons technologiques (améliorations continues des équipements) et sociales (conflits sociaux pour améliorer la situation des salariés) et à l’expansion du capitalisme pour intégrer de nouvelles forces de travail sans expérience du travail industriel. Chaque nouvelle conception émerge, puis dépasse la précédente tout en intégrant sous de nouvelles modalités, sociales et politiques, les salariés caractéristiques de la nouvelle organisation.
III. La fin du modèle du New Deal
La bifurcation actuelle marque l’achèvement du modèle du New Deal et du compromis social-démocrate (concept moins réducteur que celui de compromis fordiste souvent utilisé) et une critique du paradigme de l’OST. Les obstacles à la poursuite du modèle ont suscité trois réponses :
- le perfectionnement de ses caractéristiques économiques, politiques et sociales (le Programme commun en France) sans améliorations sensibles de la situation (type stagflation) ;
- la multiplication des tentatives d’aménagements de l’organisation du travail avec des résultats décevants dans la durée au sein des pays développés (l’OCDE) ;
- la délocalisation des productions vers les pays en développement, en y implantant des établissements retrouvant les formes les plus brutales de l’OST à ses débuts par la mise au travail de populations souvent rurales sans expérience industrielle.
Ce processus a d’abord pris la forme d’une internationalisation du capital (Palloix, 1975) avec la désarticulation des systèmes productifs (Andreff et al., 1974) par les délocalisations puis s’est poursuivi avec la mondialisation structurée autour en chaînes de valeur.
A. Le modèle social-démocrate ou du New Deal
La Première Guerre mondiale marque l’échec de la première mondialisation (Berger, 2003), sous sa forme impérialiste de partage du monde, du protectionnisme, du nationalisme et de la violence des luttes sociales. Elle débouche sur une bifurcation longue à partir de 1917. L’effondrement du système impérialiste entraîna la substitution de l’hégémonie des puissances européennes (ruinées ou dévastées par la guerre) par les États-Unis et le Japon avec une intervention globale des pouvoirs publics sur leur espace national selon plusieurs modalités au cours des décennies 1920-1940. Une synthèse résume en quatre options les solutions retenues : le conservatisme antimoderne (le Portugal salazariste), la modernisation autoritaire (l’Italie fasciste), la construction autoritaire du socialisme (l’Union soviétique), le réformisme social et politique (les États-Unis du New Deal, la France du Front populaire). Les violences et les guerres se terminent par une division du monde selon deux versions du même paradigme du point de vue du travail : l’organisation scientifique du travail (OST). Le soviétisme en inaugure dès l’entre-deux-guerres une approche autoritaire standardisée, offrant peu de possibilité d’innover, érigée en impératif dans le monde « socialiste ». Le New Deal esquisse une première version démocratique largement promue ou imposée ensuite par les États-Unis (Varoufákīs, 2015) sous des formes diversifiées selon les pays, dont les versions des formes d’État providence ou d’État social en Europe occidentale qui incorporent des traits venus du corporatisme antérieur (Nord, 2016), dans des variantes d’un néocorporatisme démocratique (Eichengreen, 2007).
La réduction au taylorisme ou au fordisme des formes d’État providence ou d’État social ne rend pas compte de leur complexité et suppose un déterminisme étroit entre les technologies et les formations économiques et sociales dont les travaux sur la diversité des capitalismes en montreront les limites (Crouch & Streeck, 1996). L’OST standardise les méthodes et rationalise les processus de travail par une division stricte entre la conception (cadres supérieurs), l’exécution (ouvriers spécialisés) et le contrôle du respect des normes (cadres moyens). Cette structure permet de mettre au travail des personnes sans aucune formation professionnelle en contrepartie, elle engendre une demande de formation pour de nouvelles catégories sociales, les cadres exécutifs et les cadres dirigeants, une bourgeoisie salariée pour reprendre le concept proposé par Milner (Milner, 1997) pour caractériser les gestionnaires des entreprises en conflit-coopération avec les actionnaires.
La rupture de 1974 (Dubois, 1980) confirme les limites de cette forme d’organisation sans qu’apparaisse un nouveau paradigme. Progressivement, des innovations émergent pour dépasser la normalisation des méthodes et faciliter l’adaptation des entreprises aux défis de la mondialisation. Ces méthodes valorisent la flexibilité de l’organisation de la production, la polyvalence, l’initiative des salariés, le juste à temps concomitants à l’association des ordinateurs aux machines et équipements (machines à commande numérique, robots de première génération…), elles s’accompagnent d’enquêtes et de recherches sur la réalité de l’organisation effective du travail. Ces études démontrent l’écart entre les préconisations des bureaux d’études et la réalité effective de l’exécution des tâches réorganisées par les salariés (Linhardt, Oddone).
Les cercles de qualité devaient permettre de mieux faire partager aux salariés les objectifs de l’entreprise en les associant aux réflexions sur l’organisation du travail. Ces formes suscitent des réactions de rejet comme en leur temps les premières machines (mouvement luddite) ou le travail à la chaîne.
C’est ce paradigme épuisé (révolte des OS, hausse du prix de l’énergie, détérioration de l’environnement, faible croissance du PIB) qui conduisit dans une mondialisation néolibérale à délocaliser des procès de travail taylorisés vers des pays à faibles salaires et peu de protection sociale. Les instabilités du modèle ouvrent la perspective à un nouveau paradigme.
B. La mondialisation : une solution temporaire
La Grande-Bretagne et les États-Unis chercheront à travers la mondialisation une réponse à leurs difficultés économiques et financières par une stratégie réfléchie de démantèlement du modèle du New Deal en organisant une délocalisation des procès de travail taylorien désormais inefficients. Les systèmes productifs nationaux perdent graduellement leur cohérence avec la délocalisation de secteurs entiers ou de segments de la chaîne de production. L’éclatement des processus productifs permet une plus grande flexibilité dans l’organisation des phases de la production particulièrement sur le plan géographique à travers la constitution de réseaux (Veltz, 2008). Les processus de délocalisation des dispositifs productifs de l’OST se reproduisent pour les émergents comme la Chine ou la Corée du Sud confrontés aux mêmes blocages que ceux qu’avaient connus les pays développés, accélérés par la mutation numérique des procès de production. Les délocalisations se généralisent à l’ensemble du monde en Asie et singulièrement en Afrique relativement peu touchée par la mondialisation des décennies 1980-2000. Cette extension signe la fin inéluctable de cette dynamique néolibérale. La crise financière de 2007-2008 marque les limites du néolibéralisme mondialisé, après une période faste de croissance et de développement, pour de nombreux pays, dont la Chine. Le néolibéralisme face à deux de ses contradictions majeures, la dégradation accélérée de l’environnement, la montée indubitable des inégalités (économiques, sociales, politiques), ne propose aucune solution crédible d’où l’entrée dans une période d’incertitude, une nouvelle bifurcation du capitalisme désormais mondial. Les désordres de la mondialisation traduisent également une modification de la géopolitique mondiale avec la perte de l’hégémonie idéologique, politique et économique de l’Occident, célébrée à son apothéose (Fukuyama, 1992) au moment de la disparition de l’Union soviétique, par l’essor de l’Orient. La politique étasunienne et européenne d’endiguement du Japon ne semble pas pouvoir se répéter avec la Chine qui vise à retrouver sa place de première puissance mondiale avec la politique « Une ceinture une Route » (Frankopan, 2018) dans la constitution d’un système d’alliances complexes.
La segmentation internationale de la production dessine une nouvelle division internationale du travail et donc des emplois avec une nouvelle structure des emplois décrite comme une bipolarisation (Artus & Virard, 2018). L’emploi industriel des pays de l’OCDE diminue au profit des PECO et des émergents. La structure des emplois tend à se polariser avec d’un côté des emplois peu qualifiés et peu productifs (distribution, l’hostellerie-restauration, services à la personne) et de l’autre des emplois qualifiés des secteurs recourant aux technologies numériques. Les emplois intermédiaires souvent industriels diminuent sous l’effet de la numérisation et la robotisation, les possibilités de promotion pour les moins qualifiés se réduisent. Cette configuration du travail entre en conflit avec la croissance continue des formations ; les emplois disponibles ne correspondent pas à ceux attendus d’où un sentiment de déclassement avec des effets d’éviction des moins qualifiés. Ces changements se répercutent sur l’emploi, le chômage et l’organisation du travail. Les travailleurs à faible productivité ne se déplacent pas vers les secteurs à forte productivité (manque, de formation, de qualifications, de compétences, de mobilité), ils se retrouvent au chômage avec de faibles espérances de retrouver un emploi y compris dans les emplois de service. Les salariés les moins qualifiés et les moins mobiles forment la grande masse des perdants de la mondialisation contrairement à ce que pouvait affirmer P. Krugman (Krugman, 1998).
La possibilité pour certains chômeurs de retrouver un emploi se réduit d’où les mesures d’assistance généralisée, associées à des politiques de contraintes pour obliger les chômeurs à accepter des emplois proposés (les lois Hartz, Allemagne) soit des contrats zéro heure (Grande-Bretagne) soit par la multiplication des CDD de très courte durée (France). La flexibilité du travail ne doit pas être confondue avec la flexibilité des emplois et la multiplication des formes d’emploi souvent précaire. Les dispositions diverses visent à faire supporter aux salariés les aléas de la conjoncture (diminutions des coûts de licenciement, création de contrats de travail moins protégés…) pour assurer aux entreprises de plus grandes possibilités pour ajuster les emplois et les salaires. Ces formes de flexibilité ne résolvent pas l’incohérence, l’incompatibilité centrale entre les emplois proposés et les niveaux de formation des salariés. L’enjeu se situe dans la transformation de l’organisation du travail et des entreprises fondées sur les innovations technologiques et sociales.
IV. L’émergence de nouvelles organisations du travail
Les effets de la mutation technologique comme des conceptions du travail et de l’insertion des salariés dans l’entreprise provoquent des controverses tant sur l’avenir du travail que sur celui des entreprises et du capitalisme. Les visions catastrophiques correspondent plus à l’extrapolation de tendances que de véritables solutions que ce soient les annonces de la fin du travail ou celle d’un travail totalement flexible. Les processus en cours montrent plus des adaptations que de véritables ruptures.
A. La fin ou la mutation du travail ?
Avec l’utilisation des équipements numérisés, les thématiques de la déqualification du travail et de la fin du travail deviennent très populaires.
Le conflit entre l’utilisation des machines et le travail humain traverse les débats sur le travail depuis la première révolution industrielle. Le mouvement des luddites en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle comme les révoltes des ouvriers du textile en France au XIXe traduisaient un refus de la modernité par la crainte de déqualification du travail. Au cours de la grande mutation des années 1930, J-M Keynes introduisit l’expression de chômage technologique pour expliquer son niveau malgré une diminution des salaires. Cette inquiétude touche également les salariés dès les débuts de l’automatisation numérique au cours de la décennie 1970 avec la crainte d’un processus de déqualification-surqualification du travail (Freyssenet, 1977).
L’annonce de la fin du travail se situe dans une autre perspective comme l’illustre Hannah Arendt en 1958 (Arendt, 1961), puis André Gorz en 1988 (Gorz, 1988) ou plus récemment, par Jeremy Rifkin en 1995 (Rifkin, 1996). Les auteurs envisagent, également, une raréfaction inexorable des emplois. La politique des 35 heures en France s’appuie sur cette vision d’un partage inévitable des emplois disponibles. L’émergence du big data et de l’intelligence artificielle transforment la problématique, certains auteurs estiment que 47 % des emplois aux États-Unis pourraient disparaître (Méda, 2005). Les données disponibles ne confirment pas les prédictions. Pour ce qui est de la France, l’expansion de la population active s’effectue par la part croissante du travail salarié et la stagnation du travail indépendant.
Personnes en emploi
|
2007 |
2018 |
2021 |
|
|
Population active en emplois (en milliers) |
25 628 |
29 316 |
28 902 |
|
Indépendants (en %) |
8,5 |
8,0 |
12,6 |
|
Salariés (en %) |
91,5 |
92,0 |
87,4 |
Source : Insee, enquêtes Emploi
Le développement des emplois indépendants dans les services innovants aux entreprises et aux particuliers et des autoentrepreneurs (microentrepreneurs depuis 2017) compense la réduction de l’emploi agricole et du commerce alors que la salarisation croissante des professions libérales (personnels de santé, avocats…) augmente le nombre de salariés.
Le remplacement des salariés par des travailleurs juridiquement indépendants des entreprises individuelles et des microentrepreneurs substituerait un contrat commercial au contrat de travail avec des travailleurs plus indépendants plus mobiles. Les plateformes remplacent les salariés par des microentrepreneurs, avec la fin de la coupure entre travail et non-travail, vie professionnelle et vie privée et une astreinte permanente avec une autonomie moindre qu’un salarié. Les salariés subsistants, temporaires et précaires, assureraient les tâches résiduelles impossibles à externaliser. Une telle organisation signifie la fin de la solidarité entre les salariés assurés par le système de protection sociale, pour des protections librement choisies assurées par des entreprises spécialisées, puisque les indépendants assument le risque économique et social. Les variations de répartition entre le travail salarié et les contrats commerciaux dépendent de l’évolution des coûts de la coordination des activités économiques par l’organisation (l’entreprise) et par le marché (transaction) (Coase, 1987),
De même, loin des hypothèses sur la déqualification inéluctable du travail, la distribution des diplômes de la population active montre une tendance ininterrompue à l’élévation des niveaux de formation. Désormais, deux tiers des personnes en emploi ont obtenu au moins le niveau du baccalauréat (59,8 % en 2016, 66 % en 2021).
Structure par diplôme des personnes en emploi en 2016 et en 2021
|
|
2016 |
2021 |
||||
|
|
F |
H |
E |
F |
H |
E |
|
Supérieur à bac+2 |
25,1 |
22,0 |
23,5 |
32,0 |
27,0 |
29,4 |
|
Bac+2 |
18,0 |
14,3 |
16,1 |
17,5 |
14,2 |
15,8 |
|
Baccalauréat ou équivalent |
20,6 |
19,8 |
20,2 |
20,9 |
20,7 |
20,8 |
|
CAP, BEP ou équivalent |
21,3 |
27,1 |
24,2 |
17,9 |
23,8 |
20,9 |
|
Aucun diplôme, brevet des collèges |
14,4 |
16,2 |
15,3 |
11,3 |
13,9 |
12,6 |
|
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
F : femmes, H : hommes, E : ensemble. Source : Insee
L’ampleur des transformations du monde du travail s’explique par une modification des technologies. Une étude récente de l’OCDE (OCDE, 2019) estime qu’au cours des 15 à 20 prochaines années avec le recours aux technologies numériques, une partie des emplois risquent de disparaître en raison de l’automatisation ou de subir de profondes transformations, en particulier pour les emplois moyennement qualifiés. Les créations d’emplois entre 2005 et 2016 s’effectuent pour 40 % dans des branches avec une forte dimension numérique. Face à l’ampleur des changements, les réponses tiennent à l’institution de nouvelles régulations politiques et sociales, notamment dans le domaine de la formation et des relations sociales, au détriment des arguments économiques, en rupture avec les croyances néolibérales d’une prééminence absolue des marchés.
À cette perspective de l’émergence d’un nouveau capitalisme s’opposent diverses alternatives fondées sur la disparition progressive du capitalisme. Alors que R. Castel (Castel, 1999) considère le salariat comme un acquis précieux, qui attire une bonne partie de la population, d’autres appellent à libérer le travail (Coutrot, 2018) et considèrent que le salariat comme une forme dépassée. Outre l’extension des entreprises individuelles et des microentrepreneurs, la généralisation des formes coopératives pourrait constituer une forme de dépassement du capitalisme sans éliminer le salariat. La forme coopérative, si elle modifie la gestion de l’entreprise, conserve le statut de salarié et de la subordination du salarié. Le dépassement du salariat pourrait également prendre la figure de systèmes fondés sur des communautés collaboratives avec le retour des communs (Coriat, 2015). Les expériences historiques du socialisme sous les formes soviétique ou maoïste n’aboliront pas le salariat ; pas plus que les pays engagés dans des « voies non capitalistes » de développement. La catastrophe des communes populaires chinoises illustre également l’aspect pour le moins autoritaire des solutions communautaires.
Outre les gains liés à la coopération, que K. Marx incluait dans la survaleur, l’histoire des entreprises montre les dispositifs développés pour stabiliser et fidéliser une partie importante de la main-d’œuvre en lien avec l’utilisation de machines coûteuses. Les transformations du travail, l’affaiblissement des délocalisations comme les nouvelles demandes des salariés conduisent à envisager une nouvelle conception de l’entreprise. En ce sens, des auteurs comme R. Gordon, L. Hyman ou O. Cass défendent la thèse que la généralisation de l’usage des technologies numériques et de l’intelligence artificielle induira des ruptures dans les systèmes d’organisation comme du contenu du travail. Il devrait en résulter sur une nouvelle conception de l’entreprise.
B. L’avènement d’une nouvelle entreprise ?
Dès les premiers dysfonctionnements des entreprises taylorisées, des interrogations reconnaissent les limites du modèle de l’entreprise de l’OST fondé sur l’exclusion des salariés de leur gouvernance. La reconnaissance de la légitimité des salariés à participer aux choix stratégiques de l’entreprise (codétermination en Allemagne, comité d’entreprise en France) date des débuts du compromis social-démocrate. En France, le comité d’entreprise et les comités d’établissement institués par l’ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 1946 obligent les directions des entreprises de cinquante salariés et plus de consulter le CE en matière de gestion et de marche de l’entreprise, communiquer les documents remis aux actionnaires. Les fonctions économiques des CE ne se développeront pas par la conjonction de l’hostilité patronale (atteinte au droit de propriété) et du désintérêt syndical (collaboration de classe) pour mettre en œuvre ces dispositions. Le compromis social de la période du New Deal reposait sur la redistribution de la plus grande partie des gains de productivité aux salariés en échange de leur absence de participation à la gouvernance des entreprises, une prérogative des gestionnaires, avec néanmoins des dispositifs de participation aux bénéfices. Des réflexions pour une transformation des entreprises apparaissent dès la décennie 1960 en relation avec les premières difficultés du modèle existant dont le rapport de François Bloch-Lainé (Bloch-Lainé, 1967), puis pour la décennie 1970 celui de Pierre Sudreau (Sudreau, 1975). Ces rapports préconisent une plus grande participation effective des salariés aux choix stratégiques des entreprises, les lois Auroux de 1982 en retiendront certains éléments.
Cependant, avec le retour de l’influence de la pensée libérale, illustrée par l’article de Milton Friedman (Friedman, 1970), la maximisation de la création de valeur pour les propriétaires devient le seul objectif des gestionnaires, y compris au détriment de l’entreprise elle-même. Avec la théorie de l’agence, les dirigeants comme les salariés deviennent des agents à contrôler. Les réformes de l’entreprise se réalisent au profit de l’alliance des propriétaires et des financiers comme partie prenante du capitalisme néolibéral mondialisé, le capitalisme patrimonial selon l’analyse d’Aglietta (Aglietta, 1999).
Les débats sur l’entreprise, sa nature et son objet social se renouvellent dans la période actuelle en vue de modifier la gouvernance des entreprises. En témoignent deux publications récentes l’ouvrage de Blanche Segrestin et Armand Hatchuel (Segrestin & Hatchuel, 2012) et le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard (Notat & Senard, 2018). Ces réflexions distinguent l’entreprise, sans existence légale, de la société détenue par ses propriétaires, cette dichotomie constitue le soubassement d’un article (61) de la proposition de loi Pacte d’ajouter à l’article 1833 du Code civil français « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » un alinéa étendant l’objet social de l’entreprise « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ».
Ce nouvel article défini juridiquement, la notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) et de l’intégration dans la gouvernance de l’ensemble des effets résultant de l’activité de l’entreprise y compris les externalités qui affectent son environnement. L’exécution d’un tel programme requiert l’intervention de tous les acteurs affectés par les activités de l’entreprise : les parties prenantes (stakeholders). La gouvernance des entreprises associerait outre les actionnaires (shareholders), les dirigeants et les parties prenantes comprenant les salariés, les agents économiques en relation avec l’entreprise (les créanciers, les sous-traitants, les clients, les fournisseurs, les consommateurs), ainsi que des représentants de la société civile (associations de consommateurs, de défense de l’environnement, de riverains…), des responsables des institutions politiques (collectivités locales, l’État voire l’Union européenne). La RSE peut également constituer une réponse à des imperfections de marché et se substituer à l’application des réglementations en cas de défaillance des gouvernements comme l’observent R. Bénabou et J. Tirole (Crifo & Forget, 2013). Les formes concrètes des entreprises restent à inventer. Ces mutations apparaissent en premier lieu comme des expérimentations dans certaines entreprises pour des raisons contingentes, leur succès et leur validation permettront une propagation puis une généralisation au sein d’un compromis spécifique du développement durable.
V. L’invention d’un nouveau compromis social
L’émergence d’un nouveau paradigme technico-économique devra proposer des réponses pérennes aux trois défis (croissance soutenable, réduction des inégalités sociales, intégration des préoccupations environnementales) pour lesquels le modèle de mondialisation néolibéral n’offre pas de solution.
Face à l’ampleur des changements, les réponses tiennent à l’institution de nouvelles régulations politiques et sociales, notamment dans le domaine de la formation et des relations sociales, au détriment des arguments économiques, en rupture avec les croyances néolibérales. La relation salariale en profonde mutation avec des demandes fortes de polyvalence, de renouvellement des compétences implique une transformation des entreprises et l’invention de nouvelles conventions sociales.
La nouvelle conception de l’entreprise tend à masquer la spécificité de la relation de travail et des salariés au sein de cette pléiade d’acteurs. Les liens de l’entreprise avec la constellation de participants relèvent de relations encadrées par des droits très divers : pour du droit du travail, du droit commercial, du droit financier, du droit public, du droit de l’environnement… Cette formalisation complexe concrétise l’intégration progressive, résultats de luttes et de conflits, des intérêts des salariés et des diverses parties prenantes à influer sur les décisions des entreprises, sans que cela représente une nouveauté dans la réalité de leur fonctionnement. L’absence de distinction entre les parties prenantes conduit à reléguer les salariés du cœur du fonctionnement des entreprises à des agents parmi d’autres. Néanmoins, les salariés ne sont pas une partie prenante comme les autres. La subordination du salarié à l’employeur comme l’existence d’un collectif de travail, une organisation coopérative, évolutive, réfléchie et d’apprentissage, intéressé aux résultats de l’entreprise, expliquent le rôle particulier des salariés dans une gouvernance rénovée des entreprises. Comme le souligne Olivier Favereau (Favereau, 2019), l’entreprise se révèle avant tout comme un espace de coopération entre des acteurs engagés librement. L’entreprise n’existe que par la rencontre des apporteurs de capital et des apporteurs de travail (investissement en capital humain). Les formes précises de l’institutionnalisation des salariés à la gouvernance des entreprises résulteront des transformations des relations professionnelles dans un processus de conflits-coopérations entre les participants.
Les formes d’organisation du travail et des entreprises, vraisemblablement, coexisteront sous la contrainte de productivité de la forme dominante. La grande industrie taylorisée n’a fait disparaître ni l’artisanat ni les coopératives et les exploitations agricoles ne se sont pas transformées en entreprises capitalistes. Le nouveau paradigme social numérique se concrétisera sous des formes propres à chaque formation économique et sociale comme le résultat de luttes, de conflits, de négociations pour aboutir à un compromis spécifique comme ce fut le cas pour le paradigme précédent avec une diversité des capitalismes (Amable, 2005), et des formes nationales d’État providence ou social (Esping-Andersen, 2007). La période de consolidation du nouveau paradigme assurera une cohérence entre le travail, l’organisation du travail, les emplois et les régulations politiques et sociales.
Les transformations du travail et l’intégration économique au sein de l’UE ou dans l’ensemble du monde peuvent faire naitre un sentiment d’insécurité. L’État-nation doit mettre en place un espace de solidarité pour la protection de sa population. La solidarité est ancrée dans la pensée européenne dans le mouvement ouvrier comme dans la démocratie chrétienne constituant une dimension essentielle de la démocratie, à la fois comme un mécanisme de réduction des inégalités par la redistribution des revenus, et un concept social, culturel et politique assurant la pérennité des relations sociales entre les individus et les groupes pour agir ensemble avec leurs différences. Cette solidarité devra être refondée contre la dénonciation des formes de redistribution (assimilées à l’assistanat), pour assurer la concurrence pour les emplois entre tous sans discrimination, pour garantir durablement plus de sécurité ou réduire l’insécurité. Les bénéfices des mutations doivent compenser les pertes, les gains des gagnants partiellement redistribués aux perdants sauf à engendrer une forte instabilité politique. La réduction de l’influence de l’État social-démocrate (providence ou social) fondée sur la croyance de l’autorégulation des marchés et l’exclusion des salariés tant de la gouvernance des entreprises que de la participation aux décisions politiques et économiques contribuent à renforcer les antagonismes de toutes natures. La sortie comme la durée de la période de bifurcation dépendra de la capacité des forces politiques et sociales à inventer un développement durable basé sur les technologies de l’information et de la communication assurant une croissance qualitativement différente, socialement inclusive et écologiquement soutenable.
Bibliographie :
Aglietta, M. (1999), « Les transformations du capitalisme contemporain », in Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Paris, La Découverte.
Amable, B. (2005), Les cinq capitalismes : diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation, Paris, Éd. du Seuil (Économie humaine), 373 p.
Andreff, W., Deleplace, G., Gillard, L., Duboeuf, F. Lespès, J.-L. & Sardais, L. (1974), « Internationalisation du capital et processus productif : une approche critique », Cahiers d’Économie politique, vol. 1, n°1, p. 9‑121.
Arendt, H. (1961), Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy.
Artus, P. & Virard, M.-P. (2018), Et si les salariés se révoltaient ? : pour un nouvel âge du capitalisme, Paris, France, Fayard.
Berger, S. (2003), Notre première mondialisation : leçons d’un échec oublié, traduit par Robert R., Paris, Seuil (La République des idées).
Bloch-Lainé, F. (1967), Pour une réforme de l’entreprise, Paris, Éditions du Seuil, 191 p.
Castel, R. (1999), Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, France, Gallimard, 813 p.
Coase, R. (1987), « La nature de la firme, 1937 », Revue française d’économie, vol. vol II/1, p. 133-163.
Conseil constitutionnel (2019), « Constitution du 24 juin 1793 », https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793.
Coriat, B. (2015), Le retour des communs : la crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Éditions les Liens qui libèrent, 297 p.
Coutrot, T. (2018), Libérer le travail : pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer, Le Seuil.
Crifo, P. & Forget, V. (2013), « La responsabilité sociale et environnementale des entreprises : mirage ou virage ? », hal-00830642, p. 23.
Crouch, C. & Streeck, W. (1996), Les capitalismes en Europe, Paris, Éd. la Découverte (Recherches).
Destanne de Bernis, G. (1977), « Régulation ou équilibre dans l’analyse économique », in L’idée de régulation dans les sciences, Paris, Maloine-Doin.
Diderot, D., D’Alembert, J.L.R. dit & Jaucourt, L. de (2019), « ENCCRE – Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie ».
Doray, B. & Godelier, M. (1981), Le taylorisme, une folie rationnelle ? Paris, France, Dunod, DL 1981.
Dubois, P. (1980), « La rupture de 1974 », Économie et statistique, n°124.
Eichengreen, B.J. (2007), The European economy since 1945: coordinated capitalism and beyond, Princeton (N.J.), Princeton university press (The Princeton economic history of the Western world).
Esping-Andersen, G. (2007), Les trois mondes de l’État-providence : essai sur le capitalisme moderne : épilogue inédit de l’auteur pour l’édition française, traduit par Merrien F.-X. & Martin N., Paris, Presses universitaires de France (Le Lien social), Paris. 1997.
Favereau, O. (2019), « L’entreprise est un espace politique », Alternatives économiques, n°389.
Frankopan, P. (2018), Les nouvelles routes de la soie : l’émergence d’un nouveau monde, traduit par Villeneuve G., Bruxelles, Belgique, Éditions Nevicata.
Freyssenet, M. (1977), La division capitaliste du travail, Paris, France, Savelli, impr. 1977.
Friedman, M. (1970), « The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre 1970.
Fukuyama, F. (1992), La fin de l’Histoire et le dernier homme, traduit par Canal D.-A., Paris, Flammarion.
Gorz, A. (1988), Métamorphoses du travail, quête du sens : critique de la raison économique, Paris, Galilée (Débats).
Institut national de la statistique et des études économiques (1991), Deux siècles de travail en France, Paris, Insee (Insee études).
Kondratiev, N.D. (1992), Les grands cycles de la conjoncture, traduit par Cahuet I. & Peaucelle I., Louis Fontvieille (dir.), Paris, France, Economica.
Krugman, P.R. (1998), La mondialisation n’est pas coupable : vertus et limites du libre-échange, traduit par Saint-Girons A. & Vergara F., Paris, Éd. la Découverte (Textes à l’appui).
Méda, D. (2005), Le travail, 2e éd, Paris, Presses universitaires de France (Que sais-je ?).
Milner, J.-C. (1997), Le salaire de l’idéal : la théorie des classes et de la culture au XXe siècle, Paris, Éd. du Seuil (Seuil, essais).
Nord, P.G. (2016), Le New deal français, traduit par Bessières M., Paris, Perrin.
Notat, N. & Senard, J.-D. (2018), « L’entreprise objet d’intérêt collectif », Ministère de l’Économie.
OCDE (2019), L’avenir du travail. Perspectives de l’emploi de l’OCDE, OCDE.
ONU (2015), « La Déclaration universelle des droits de l’homme », https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/.
Orléan, A. (2013), L’empire de la valeur : refonder l’économie, Paris, Éd. du Seuil (Points).
Palloix, C. (1975), L’Internationalisation du capital : éléments critiques, Paris, F. Maspero (Économie et socialisme).
Pomeranz, K. (2010), Une grande divergence : la Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, traduit par Wang N., Paris, A. Michel Maison des sciences de l’homme (Bibliothèque de l’évolution de l’humanité).
Rifkin, J. (1996), La fin du travail, traduit par Rouve P., Paris, Éd. la Découverte (Cahiers libres).
Segrestin, B. & Hatchuel, A. (2012), Refonder l’entreprise, Paris, France, Seuil, 119 p.
Smith, A. (1776), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduit par Garnier G. & Blanqui A., Daniel Diatkine (dir.), Paris, Flammarion (GF).
Sudreau, P. (1975), La Réforme de l’entreprise : rapport, Paris, Union générale d’éditions (10-18).
Thévenot, L. (1985), « Les investissements de forme », in Conventions économiques, Paris, PUF.
Valenduc, G. (2018), « Révolutions technologiques et transitions dans la société », Notes de prospective, n°04.
Varoufákīs, G. (2015), Le Minotaure planétaire : l’ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial, traduit par Goulon O., Puteaux, Enquêtes & perspectives.
Notes:
[1] L’augmentation des « cadres » et la stagnation des « professions intermédiaires » tient , pour partie, à un effet de reclassement des enseignants dans la catégorie cadres (niveau master)